Un accord sur le volet agricole enfin conclu
Un accord sur le volet agricole du règlement omnibus, qui renforce les outils de gestion des risques et le pouvoir de négociation des organisations de producteurs, a été trouvé, malgré les fortes réticences des autorités de la concurrence de Bruxelles.
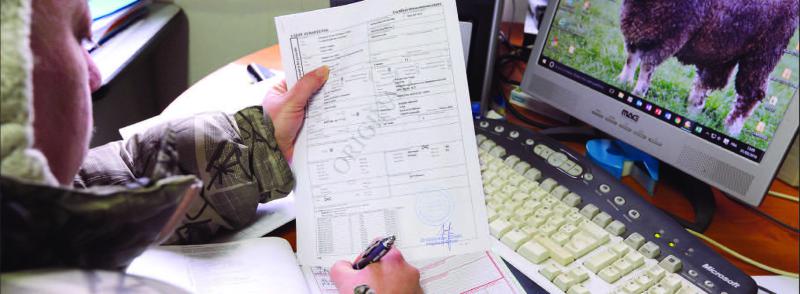
Les experts des États membres ont donné leur accord le 16 octobre au compromis trouvé quelques jours plus tôt entre le Parlement européen et la présidence estonienne du Conseil de l’UE sur le volet agricole du règlement omnibus qui va permettre une adaptation à mi-parcours de la Pac. Alors que leurs demandes pouvaient paraître disproportionnées de prime abord, les eurodéputés ont finalement réussi à imposer les principaux points de leur «mini-réforme», avant l’heure de la Pac, en renforçant les outils de gestion des risques et le pouvoir des organisations de producteurs.
Les trois points les plus problématiques de la négociation auront été : les règles s’appliquant aux organisations de producteurs, les dispositifs d’assurances et la simplification du verdissement des paiements directs. Sur les deux premiers, les eurodéputés ont obtenu gain de cause.«La plupart des idées du Parlement sur la simplification, la gestion des risques et les mesures de marché sont désormais incluses dans le texte final», s’est félicité Paolo De Castro (socialiste, Italie), en charge des négociations pour le Parlement. Pour le député européen français Michel Dantin, l’un des négociateurs du texte, il s’agit d’une «révision profonde du régime des organisations de producteurs et du droit de la concurrence européen».
Ces nouvelles dispositions devraient entre en vigueur dès 2018. Le think tank bruxellois Farm Europe estime qu’il s’agit d’une «véritable révision à mi-parcours du volet économique de la Pac».
Outils de gestion des crises améliorés
Partant du constat que le dispositif d’assurance mis en place lors de la dernière réforme de la Pac en 2003 n’était que très peu utilisé par les agriculteurs, la Commission européenne avait proposé que le seuil de déclenchement de l’instrument de stabilisation des revenus passe de 30 % de pertes à 20 % au niveau sectoriel, c’est-à-dire couvrant un secteur d’activité en particulier, par exemple le lait, et non pas l’ensemble des activités de l’exploitation. Mais le Parlement européen a voulu aller plus loin et demandait que ce seuil de 20 % soit étendu à l’ensemble des dispositifs assurantiels.
Ce ne sera pas le cas, mais le compromis final prévoit que, pour les contrats d’assurance ce taux de 20 % de pertes soit également appliqué. Par contre, pour l’instrument de stabilisation de revenu général (et non pas sectoriel) et pour les fonds de mutualisation, ce seuil est maintenu à 30 %.Autre évolution : pour l’ensemble de ces dispositifs de gestion des risques, la compensation est portée jusqu’à 70 % (au lieu de 65 % précédemment). Ces outils peuvent être cofinancés en partie par les fonds du deuxième pilier (70 % pour les assurances récoltes et 25 % pour l’instrument de stabilisation des revenus).
Organisations de producteurs renforcées
Les membres de la commission parlementaire de l’agriculture ont également insisté dès le début des négociations sur la nécessité de renforcer la position de négociation des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Un volet que la Commission de Bruxelles n’avait pas prévu d’ouvrir. Mais au final, les eurodéputés ont obtenu l’extension des règles s’appliquant déjà aux secteurs du lait, de l’huile d’olive et des céréales à l’ensemble des autres filières.Tous les agriculteurs seront donc en droit d’avoir des contrats précisant clairement les prix et les volumes, pourront regrouper leurs forces pour vendre collectivement leurs produits, définir les quantités et les standards de qualité au sein de leur organisation de producteurs ou de négocier le partage de la valeur au sein des interprofessions, comme dans le secteur du sucre aujourd’hui (voir encadré).
De plus, la limite de concentration de 33 % pour une production donnée au niveau national et de 3,5 % au niveau européen est levée. Des dispositions jugées très problématiques par la Commission, en particulier la direction générale de la concurrence, qui publiera d’ailleurs parallèlement au règlement une déclaration pour indiquer qu’elle aurait souhaité un certain nombre de garde-fous pour permettre une surveillance accrue de la part des autorités nationales. En revanche, les députés européens n’ont pas obtenu d’avancées sur les outils de gestion et prévention des crises.
Simplification à la marge
Sur le volet de la simplification de la législation, les avancées sont plus marginales. Les discussions ont notamment porté sur le verdissement des aides directes. Les exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont consacrées à la production d’herbe, de plantes fourragères ou couvertes par des prairies permanentes sont toutes exemptées des règles du verdissement (alors que jusqu’à présent celles de plus de 30 ha devaient s’y conformer). Trois plantes supplémentaires sont ajoutées à la liste de cultures pouvant être reconnues comme surfaces d’intérêt écologique (SIE) : le miscanthus, la silphie perfoliée et les plantes mellifères.
Mais comme cela a déjà été décidé par la Commission, il ne sera plus possible d’avoir recours à des traitements phytosanitaires sur ces surfaces à partir de 2018. Les autres dispositions proposées par la Commission européenne ont été adoptées : plus grande flexibilité au niveau national pour dé-finir ce qu’est un agriculteur actif, simplification de l’accès aux instruments financiers, possibilité de faire passer le complément d’aides directes pour les jeunes agriculteurs («top up») de 25 % à 50 % dans la limite de l’enveloppe disponible. Par contre, sous la pression du Conseil, les conséquences budgétaires en cas de non-recouvrement de paiements indus restent prises en charge à 50 % par les États membres et à 50 % par la Commission et non pas comme l’aurait souhaité Bruxelles à 100 % par l’État membre concerné. Pour aller plus loin, il faudra attendre la prochaine réforme de la Pac. La Commission européenne doit présenter les grandes lignes de son projet dans une communication attendue officiellement pour la fin novembre puis mettre sur la table en 2018 des propositions législatives formelles. Mais les discussions pourraient traîner compte tenu des incertitudes budgétaires liées au Brexit.
Dans la filière sucre, une négociation collective sur la répartition de la valeur
La suppression des quotas sucre et du prix minimum de la betterave à partir de la campagne 2017-2018 a conduit à revoir les textes réglementaires qui encadrent cette production. C’est aujourd’hui l’article 125 du règlement OCM unique qui s’applique, ainsi que l’annexe X relative aux conditions d’achat des betteraves. Mais il y a deux ans, une divergence de vues est apparue entre la DG Agri et la DG Concurrence de la Commission sur l’interprétation de l’OCM unique quant à la possibilité ou non d’une négociation collective du prix entre planteurs et fabricants.
Cela a conduit à la rédaction d’un règlement délégué (2016/1166) qui dit : «Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrées sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d’autres marchés de matières premières». En France, cet acte délégué a été décliné dans l’accord-cadre interprofessionnel qui s’applique pour trois campagnes à partir de 2017-2018. Dans chaque groupe sucrier privé, une commission «répartition de la valeur» a été créée. C’est elle qui négocie tout ce qui relève du prix. Dans le cas des coopératives, le conseil d’administration ou de surveillance ou une commission désignée fait office de commission «répartition de la valeur».
Pour Momagri, les instruments de stabilisation des revenus ont un avenir limité
Selon le think tank Momagri, l’intérêt, et donc le potentiel de développement, des instruments de stabilisation des revenus semblent limités pour des raisons économiques et politiques. Momagri rappelle qu’il s’agit de fonds mutuels économiques sur indice de prix par secteur. «Cela pose un réel problème politique car il s’agit d’une forme de privatisation de l’accès au soutien public qui entamerait encore un peu plus la légitimité de la Pac : seuls les agriculteurs en mesure de cotiser les bonnes années pourront recevoir les mauvaises.»
Pour Momagri, ce type de proposition «s’inscrit dans la voie de la renationalisation de la Pac» avec les risques associés de distorsion de concurrence entre régions et États membre. «Alors que la Commission a fait la chasse depuis 30 ans aux caisses de compensation gérées par Unigrains ou à des outils tel que Stabiporc, qui servaient uniquement pour le financement des entreprises et qui n’avaient pas à apporter des subventions, ce revirement est plus qu’étrange», souligne Momagri qui soupçonne la Commission de «lâcher» sur un instrument «sans réel potentiel de développement» pour occuper les débats dans le but de conserver le statu quo sur les grandes lignes de la Pac.




Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,